 Taourirt fut de tout temps sans doute un des gros villages de la kabylie du Djurdjura. De quoi vivait sa population ? Quelles étaient ses ressources ? Celles-ci provenaient ici, comme ailleurs, de la culture du sol et d’un très médiocre artisanal sur le tournage du bois.
Taourirt fut de tout temps sans doute un des gros villages de la kabylie du Djurdjura. De quoi vivait sa population ? Quelles étaient ses ressources ? Celles-ci provenaient ici, comme ailleurs, de la culture du sol et d’un très médiocre artisanal sur le tournage du bois.
Le territoire de Taourirt est assez étendu, en champs cultivable, bois et taillis. Le sol est pauvre : du schiste que recouvre une minée couche d’humus. On comprend dès lors que le Kabyle, tout en essayant de tirer de son terroir l’essentiel de sa substance, n’ait jamis pu trouver sur place la richesse ni même l’aisance.
En grattant le sol du bout de sa charrue de bois, il en obtenait de maigres récoltes d’orge, bien insuffisante pour un unique couscous quotidien. Aussi préféra-t-il cultiver les arbres fruitiers qui réussissent très bien. Il défricha l’ancienne forêt, en conservant cependant de quoi à chauffer et faire la cuisine. Il conserva pareillement le chêne à glands doux dont les familles pauvres faisaient leur couscous. Dans les espaces défrichés, il planta le figuier, dont les fruits, séchés, fournirent un apport substantiel à sa nourriture, soit consommé avec un peu de galette et d’huile, soit échangé avec des céréales apportés par les arabes des Haut- plateaux. L’altitude ne permet pas la culture de l’olivier qui ne produit guère au-dessous de 600, 700 mètres : or, Taourirt est à 1000 mètres.
Les arbres fruitiers d’Europe s’adaptent très bien au sol et au climat du pays. Jusqu’à ce jour, cependant, seul le cerisier a été cultivé en grand (si l’on peut dire) et lon en tire des substantiels bénéfices, la main d’œuvre, familiale, ne coûtant presque rien.
L’élavage n’existe pas à Taourirt, car on ne peut appeler de ce nom le fait que la plupart des familles élèvent vaille que vaille deux ou trois moutons et chèvres. Les feuilles et frênes suffisent à peine à nourrir ce pauvre bétail pendant les mois d’été.
Pas d’artisanat mettant en œuvre les arts décoratifs : on ne trouve à Taourirt que quelques tourneurs – de plus en plus rares, d’ailleurs – qui fabriquent à partir du bois de frênes surtout les ustensiles domestiques d’usage. Plats à rouler le couscous, plats à servir…
Leur atelier, primitifs, présente, cependant, dans ses moyens techniques, une ingéniosité certaine.
En voici la description donnée par Hanoteau et Letrouneux (Tome I, 562, 563) : la notation phonétique a été remaniée :
“Les ouvriers tourneurs (aneggar, pl, ineggaren) emploient un tour à pédale et à perche, ne produisant, par conséquent, qu’un mouvement de va-et-vient.”
Bien que les plats (tarbut, pl, tirbuyin) que l’on fabrique avec cet outil rentrent dans la catégorie des ouvrages qui ne s’exécutent que sur le tour en l’air (ce tour est à pointes), il en résulte que les plats ne peuvent être terminés sur cet appareil et qu’on est obligé de les achever avec la hachette (tagelzimt, pl, tigelzyam ou tiglezyam).
Le sol est légèrement creusé à l’emplacement du tour. Le banc (Igayza) est une simple traverse en bois de chêne, grossièrement équarrie de 1m60 de longueur sur 0m.20 d’épaisseur et 0m.25 de largeur. Il est assemblé à mi-bois sur deux traverses horizontales de même dimensions qui sont maintenues par des montants verticaux fixés à une semelle (azeqqur).
Les poupées (taweqqaft, pl, tiweqqafin) ont 0m.50 de heuteur et 0m.14 de largeur et d’épaisseur. Elles sont fixés au banc par des clefs de bois (tazzelt, pl, tuzzal) l’une de ces poupées est fixe : l’autre se met dans une mortaise.
Le bois à travailler se fixe sur le tour au moyen des pointes (lehdida, pl, lehdayed) qui se trouent en haut des poupées et y adhérent par des anneaux de fer (ameqyas, pl, imeqyasen). L’une de ces pointes reçoit le derrière du plat à tourner et l’autre, un mandrin en bois (lewleb, pl, lwelbat) de 0m.30 de longueur, qui s’adapte à l’interieur du plat à l’aide de trois dents en fer (uglan). L’ouvrier, par suite de cette disposition, ne peut évider complétement l’interieur du plat, puisqu’il est obligé de laisser toujours un support pour le mandrin. Il fait diparaitre ensuite ce support avec la hachette.
La perche ou ressort (asedru, pl, isedra) est une branche de chêne-liège, de 1m.60 de longueur, qui est fichée en terre à 1m.75 en avant du tour. A son extrémité est attachée une courroie (lmejbed) qui s’enroule autour du mandrin et va se fixer à la pédale. Cette pédale (asebbad) est un morceau de frêne de 0m.40 de longueur, dont l’un des bouts est maintenu en l’air par la courroie tandis que l’autre est fixé à une cheville plantée dans le sol.
Le support (ibergen, pl, ibregnen) est une triangle de bois qui s’appuie sur deux traverses portant, d’un bout, sur le haut des poupées et, de l’autre, sur des montants verticaux placés derrière l’ouvrier (taweqqaft, pl, tiweqqafin). Ces traverses et le support sont percés de trous distants l’un de l’autre de 0m.30.
C’est au moyen de ces trous et de deux chevilles que l’on fixe le support à la distance convenable de l’objet à tourner.
Pour façonner le bois, le tourneur Kabyle n’a qu’une seule espèce d’outils. C’est un instrument en fer rond, recourbé à son extrémité en forme de rainette et muni d’un manche en bois de 0m.20 de longueur ou plus. On le nomme (aneccab, pl, ineccaben). Chaque ouvrier possède plusieurs de ces outils de différentes dimensions, mais tous ont la même forme. Ils les aiguisent au moyen d’une pierre de grès rouge qui provient du Djurdjura.
Les bois employés pour la fabrication des plats sont le frêne (aslen), l’aune (as£ersif), l’orme (ulmu), le micocoulier (ibiqes).
Agriculture, artisanat n’ont jamais suffi à nourrir toute la population de Taourirt. De tout temps, sans doute, les hommes ont dû s’exiler pour fournir aux leurs de quoi vivre. Les expéditions militaires, le commerce y ont été leurs grands occupations. Pour eux, comme partout ailleurs, s’est réalisé et continue de se réaliser le dicton : c’est en sortant de ton pays que tu t’enrichiras.
Le peu de ressources que leur rapportaient leurs champs, leurs arbres fruitiers ou petit travail artisanal, il fallait aux gens de Taourirt l’échanger pour se procurer ce qui manquait : compléments d’alimentation et vêtements. De ces derniers, on était plus sobre autrefois et porter un seroual est resté longtemps un signe de richesse, d’autorité. Il n y avait pas de boutiques dans le village : le lieu des échanges était donc le marché. De tout temps, le marché a tenu une place prépondirante dans la vie du Kabyle : on y va se ravitailler en provisions et aussi en nouvelles de toutes sortes. C’est au marché que se rencontrent les gens de differents villages, voire de différentes tribus. Cela explique la réglementation minutieuse qui les régit : (v. Hanoteau-Letourneux, T. II, pp. 77-82).
Autrefois, les habitants de Taourirt fréquentaient deux marchés, celui de Sebt (Aït-Yeahya), près d’A¨t-Hichem et celui de Djemâa, au bout de l’oued du même nom. Ce dernier marché se situait jadis en dessous d’Agouni-Teslent, d’où son nom de Djemâa-Oufella (le vendredi du haut), pour le distinguer du marché actuel sité plus bas. Ces deux marchés rivalisaient d’importance, à en croire les dires des anciens. L’installation de l’administration française à Michelet y provoqua la création d’un nouveau marché, tenu le mardi, qui finit par supplanter complètement celui de Sebt.
Taourirt fit l’essai d’un marché local, à Tizi l-Lâfir, près de l’Hôpital. Né, sans doute, de circonstances particulieres, ce marché devait disparaitre avec elles, d’autant plus facilement que sa situation sur un chemin de passage des femmes posait des problèmes sur lesquels le nif kabyle ne badine pas. Il n’en reste que le souvenir dans le dicton suivant :
- Tizi l-l£fir, win yettun a d-yemmekti !
- Le marché de T Tizi l-l£fir, que l’oublieux s’en souvienne !
Plongé dans les soucis matériels, la Kabyle reste un croyant. Son islam, bien sûr, est entaché de croyances et de pratiques que réprouve la saine orthodoxie, mais c’est sa religion, religion à laquelle il adhére fermement depuis sa plus tendre enfance mais à la pratique de laquelle il ne s’adonnera sérieusement que sur ses dernières années.
Taourirt et Ouaghzen ne manquent pas des lieux de culte destiné à abriter la prière rituelle (tazallit) : mosquée, à minaret dédiée à l’ange gabriel, Sidna Djebrayen ; mosquée, plus humble, à Ouaghzen ; tombeau de Sidi Lhadioù les khouans aiment à faire la prière du vendredi ; tombeau de Djeddi-Mangellat où se fait encore maintenant la prière des deux principales fêtes musulmanes, Laïd Tamokrant (aïd Elkebir), et Laïd Tamezyant (aïd Seghir).
Plus nombreux sont peut-être les lieux sanctifiés par la sépulture (voire même le seul passage) d’un saint personnage : des koubbas à coupole ou de rustiques mausolées à toiture pyramidale. Plus nombreux encore sont les points hantés par quelque « Gardien » : arbre, rocher ou source : c’est là que l’on viendra porter ses prières et ses offrandes, plus souvent, peut-être, que dans les lieux sanctifiés par une présence plus prestigieuse mais moi accessible.
Une des grandes dévotions est celle des pélerinages : pèlerinage collectifs lors des fêtes fixes, pèlerinages individuels ou en famille, en vue d’obtenir quelque faveur ou de remercier pour un bienfait. Le jour de tasewwiqt, petit marché supplémentaire qui permet de se procurer le nécessaire pour les deux principales fêtes, tandis que les hommes et les jeunes garçons sont absents, femmes et fillettes, parées de leurs plus beaux atours, se rendent, en battant du tambourin, au sanctuaire de Jeddi-Mangellat. Chants, religieux et profans, y alternent pendant toute la matinée. Au retour, on ne manquera pas de faire une station à la tombe du Saint tutélaire du village, Sidi Lhadi.
A l’occasion de l’Achoura, fête par excellence des pélerinages, tous, hommes et femmes, vont en visite pieuse à un santon, Jeddi-Mangellat tout spécialement.
Depuis de nombreuses années, les divertissements sans doute plus profanes qui se donnent à l’occasion de la fête de Chikh Arab (près de Taourirt-Amrane), attirent des pélerins de plus en plus nombreux.
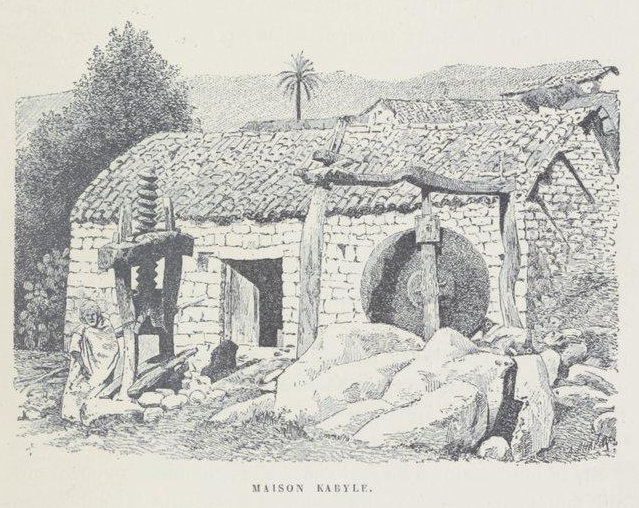 Signalant enfin, à propos de certains hauts lieux, des pratiques prophylactiques ou thérapeutiques diverses : il est conseillé de se rendre à Izra-bba£zen si l’on souffre d’une éruption cutanée : il suffit de s’y laver pour s’assurer une prompte guérison : l’eau de Tala Ousammeur, très maigre source en dessous du hameau de Tamazirt, guérit, dit-on de toutes les maladies ; à la tombe de SidiHamou, sous l’olivier franc appelé Ahcad Boukouir, on ira s’étendre pour se debarasser de la fiévre ; il convient de mentionner également le curieux rite de lapidation observé au lieu dit Imma Chouha, sur le sentier qui va de Ouaghzen à Deddi-Mangellat : le passant s’y arrête et lance une pierre en disant :
Signalant enfin, à propos de certains hauts lieux, des pratiques prophylactiques ou thérapeutiques diverses : il est conseillé de se rendre à Izra-bba£zen si l’on souffre d’une éruption cutanée : il suffit de s’y laver pour s’assurer une prompte guérison : l’eau de Tala Ousammeur, très maigre source en dessous du hameau de Tamazirt, guérit, dit-on de toutes les maladies ; à la tombe de SidiHamou, sous l’olivier franc appelé Ahcad Boukouir, on ira s’étendre pour se debarasser de la fiévre ; il convient de mentionner également le curieux rite de lapidation observé au lieu dit Imma Chouha, sur le sentier qui va de Ouaghzen à Deddi-Mangellat : le passant s’y arrête et lance une pierre en disant :
- Yemma Cuhha ur fell-ar tcuhhu !
- Mére Chouha, ne sois pas pour nous avare !
Le cortège funéraire qui gagne le cimetière de Djeddi-Mangellat fera un détour, quelque peu malaisé, pour que la civière du défunt traverse ce terrain sacré.
Le culte des morts est aussi en honneur. Sans doute, leurs tombes ne sont pas toujours respectées comme il se devait : elles disputent par trop aux vivants l’espace vital ; cependant, pour les deux fêtes majeurs et pour celle de l’Achoura, les familles vont, de très bon matin, déposer sur les tombes l’offrande aux défunts, ssadaqa n at-laxert.
